Liste des constructeurs de digesteurs de micro-méthanisation en Région wallonne
Depuis plusieurs mois, le secteur de la méthanisation voit émerger des unités de petite puissance : les unités de micro-biométhanisation. De plus, le programme BIOMETH 10 a été lancé par la Région wallonne, afin d’encourager l’installation de ce type d’unités. La « liste des constructeurs de digesteurs de micro-biométhanisation en Région wallonne » est désormais disponible sur le site de ValBiom. Elle regroupe les constructeurs et équipementiers spécifiquement actifs pour les unités de petite taille. De plus, elle explique en quelques lignes les différentes techniques existantes sur le marché, en fonction des matières entrantes.
La micro-biométhanisation concerne la biométhanisation de petite taille.
En Région wallonne, on parlera de micro-biométhanisation lorsque la puissance du moteur de cogénération est inférieure à 10 kW électrique (kWé). Le respect de cette limite permet de bénéficier du système de compensation. Ce système, tel que mis en œuvre par la Région wallonne, permet de déduire de sa consommation, sur une période donnée, l’énergie injectée sur le réseau, même si la consommation et l’injection ont été effectuées à des moments différents. La compensation revient
donc à utiliser le réseau comme « pile de stockage » dans lequel l’électricité est injectée ou prélevée tour à tour ; le bilan est effectué par période de facturation. (Source : www.cwape.be).
Les matières entrantes
En biométhanisation, toutes les matières organiques peuvent être valorisées, exception faite des matières fortement ligneuses, telles que le bois. Dans le cas de la micro-biométhanisation telle que définie par la Région wallonne, les unités ne peuvent être alimentées que par des ressources en biomasse issues de l’exploitation agricole (effluents d’élevage, résidus de cultures, etc.).
Les matières entrantes se distinguent en fonction de leur taux de matière sèche (TMS), ce qui a des conséquences sur le choix des technologies à mettre en œuvre :
- les matières liquides (généralement TMS < à 10 %) : lisiers, eaux blanches de laiterie, etc. ;
- les matières solides liquéfiables endéans quelques jours de digestion (généralement avec un
- TMS compris entre 10 et 40 %) : ce sont des matières comme les fanes de carotte ou de betterave, ou certains fumiers peu pailleux, qui se liquéfient ;
- les matières solides qui conservent une consistance solide ou fibreuse au cours de la digestion (avec parfois un TMS > 40 %) : fumiers très pailleux, paille, etc..
Techniques de digestion utilisées
Pour les matières liquides
- La digestion sur lit fixe est une technique où la matière première (contenant peu de particules ou de fibres) percole à travers un support poreux sur lequel sont fixés les micro-organismes (filtre, grille, support en nid d’abeilles, etc.). La matière digérée est ensuite évacuée soit dans une cuve de stockage, soit dans une poche de post-digestion.
- La poche de digestion est une poche où la matière est introduite et où la fermentation se déroule. Le biogaz est stocké temporairement dans la poche en attendant d’être valorisé, et le digestat est évacué régulièrement vers une cuve de stockage.
Pour les matières solides liquéfiables (et les matières liquides)
La cuve horizontale ou verticale fonctionne sur le même principe que la poche de digestion, excepté que cette technologie permet d’accepter des taux de matière sèche plus élevés. Si la cuve est mélangée en continu : on parlera d’un digesteur en infiniment mélangé, qui est la technique la plus utilisée pour les grandes installations en Région wallonne. Dans d’autres cas, le mélange se fait grâce à un piston. Le biogaz est stocké soit dans la cuve, soit dans un gazomètre.
Pour les matières solides sèches : la voie sèche
Le digesteur se présente sous forme d’un container (Voie sèche – container), d’un silo (Voie sèche – silo) ou d’un garage selon la taille de l’installation. Le digesteur est rempli à l’aide d’un engin agricole et refermé hermétiquement. Les matières y sont laissées en tas durant tout le processus de décomposition et aspergées de jus de fermentation. Ces derniers sont récupérés sous le tas, pompés, chauffés et ré-aspergés sur les matières en décomposition afin de les inoculer et les maintenir humides. Une fois les matières épuisées (c’est-à-dire ne produisant plus de biogaz), le digesteur est ouvert et le digestat (matières épuisées) est retiré de la cuve à l’aide d’un engin agricole. Ce digestat est plutôt solide, et le temps de séjour dans le réservoir est généralement de 60 jours. Le biogaz est stocké dans un gazomètre, à proximité des cuves. Le plus souvent, on installe plusieurs réservoirs en parallèle, qui seront remplis à quelques jours d’écart, permettant ainsi de lisser la production de biogaz.
Pour en savoir plus :

- Consultez la liste
- La micro-biométhanisation (Foire de Libramont – Cécile Heneffe – ValBiom) – 2013
- Dossier du projet BIOMETH10
Pour toute information complémentaire : Cécile HENEFFE, heneffe@valbiom.be, 010/47.38.18







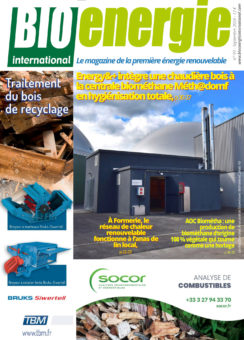


 Ventil’ ta récolte
Ventil’ ta récolte STC Biomasse
STC Biomasse